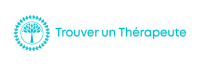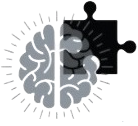
Mon Inconscient
Coach & Thérapeute de l'inconscient
Révélateur de qui vous êtes et de votre potentiel
Déconstruire tout ce qui vous a été imposé depuis toujours pour réussir à exprimer votre volonté de puissance.
Réaliser la transformation de vos mémoires émotionnelles,
et la reprogrammation de votre subconscient avec une approche holistique et intégrative.